La voie blairiste ou la voie des reniements
La voie blairiste ou la voie des reniements
Grégory04 februari 2009 – 17:46
Dans son ouvrage «La social-démocratie domestiquée. La voie blairiste», Philippe Marlière, maître de conférences au University College London, s’attache à retracer l’histoire, la théorie et l’action gouvernementale du New Labour de Tony Blair. Il y montre la voie blairiste comme celle de la rupture avec la tradition égalitaire et de justice sociale de la gauche européenne et comme une variante du néolibéralisme. Il souligne aussi que cette option constitue désormais une feuille de route pour l’ensemble de la social-démocratie du vieux continent.
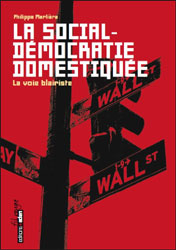
Lors de la campagne électorale de 1997, le journal The Sun avait apporté son soutien au New Labour alors que précédemment, il avait appuyé Margaret Thatcher et John Major. Ce journal appartient au groupe News Corporation, propriété de Rupert Murdoch. Lorsqu’on lui a demandé s’il avait changé d’opinion politique, l’éditorialiste politique du Sun avait répondu : « Je pense que le journal n’a pas modifié sa ligne, ce sont les travaillistes qui ont changé ». Et pour cause : depuis que Tony Blair était arrivé aux commandes du parti en 1994, on avait assisté à une droitisation de celui-ci. Ou plutôt à l’accentuation de cette droitisation commencée une dizaine d’années plus tôt.
Genèse d’une droitisation
Les élections de 1979 portent Margaret Thatcher au pouvoir et consacrent la défaite du candidat travailliste James Callaghan. Avec cette défaite, on assiste à celle d’un modèle : celui keynésien d’une économie mixte à orientation atlantiste. Le Labour, frappé de plein fouet par cette débâcle, est en outre miné par des luttes intestines entre syndicats et aile gauche d’une part, aile droite d’autre part. Dans cette lutte, la gauche marque des points : elle parvient à imposer un programme particulièrement radical basé sur l’extension des nationalisations, une politique d’investissements publics accrus, le retrait de la Communauté Economique Européenne et le désarmement nucléaire. Mais une partie de l’aile droite du Labour fait scission pour créer le Social-Democratic Party (SDP) en 1981. De plus, les travaillistes, emmenés par Michael Foot, un intellectuel de la gauche du parti, doivent faire face au climat nationaliste exacerbé de la guerre des Malouines. En 1983, c’est une nouvelle défaite électorale.
Ni l’option d’une économie mixte keynésienne à orientation atlantiste, ni celle d’une approche socialiste démocratique à orientation antimilitariste et anti-impérialiste n’avaient permis au Labour de revenir au pouvoir. Celui-ci est désorienté. En 1983, le nouveau leader du parti est Neil Kinnock, flanqué de Roy Hattersley, issu du groupe Solidarity, situé à l’aile droite. Ce duo va de 1983 à 1992 opérer une transformation fondamentale du Labour et le vider de sa composante de gauche. C’est sous cette direction que le parti va adopter les thèses thatchériennes sur l’individualisme radical, la politique socio-économique (abandon du plein emploi, priorité à la lutte anti-inflation, ...), l’intolérance sécuritaire, la volonté de mettre les syndicats à l’écart … Dès 1989, le Labour renonce à renationaliser les entreprises privatisées par le gouvernement Thatcher. En outre, les pouvoirs du leader furent considérablement renforcés au détriment de ceux des organisations, ce qui a battu en brèche la nature fédérale du Labour.
Ces tendances se sont poursuivies de 1992 à 1994 sous la direction de John Smith. Suite à son décès brutal, c’est Tony Blair qui est arrivé aux commandes et crée le « New Labour ». Comme le souligne P. Marlière, il « a été choisi par les membres de son parti car il représentait le profil idéal pour attirer le vote des classes moyennes aisées ». Il fut préféré à son rival Gordon Brown pour des raisons d’image médiatique. Là où Brown passe pour crispé, Blair donne une image décontractée et dynamique et cultive « la politique à paillettes ». De plus, il est « ami des patrons ». Avec lui, les tendances à la droitisation s’accélérèrent. Il « décréta la fin du lien privilégié entre le parti et les syndicats » (qu’il déteste) et instaura un « leadership musclé » qui « a découragé la critique constructive ou le simple débat au sein du parti ». En 1995, la clause IV de la Déclaration de Principes du Labour a été modifiée : l’attachement à « la socialisation des moyens de production, de distribution et d’échange » a laissé la place à « une économie dynamique au service de l’intérêt public, dans laquelle le marché et la rigueur de la compétition, alliés aux forces du partenariat et de la coopération, produisent la richesse dont la nation a besoin ».
Un sociologue comme chantre
Le théoricien du blairisme est un sociologue renommé, qui fut professeur à Cambridge et directeur de la London School of Economics : Anthony Giddens. Auteur de nombreux ouvrages où il expose une réflexion tantôt irritante, tantôt stimulante, il en a consacré deux à la théorisation de l’action du New Labour : « Beyond Left dans Right » et « The Third Way ». Une réflexion sociologique non dépourvue d’intérêt y côtoie des prises de position très discutables.
Selon lui, la société actuelle se caractériserait par trois tendances : mondialisation, dé-traditionnalisation (ce qui veut dire que les traditions ne sont plus tenues pour acquises, mais soumises à discussion et à appréciation critique) et réflexivité sociale accrue (ce qui veut dire que sous l’effet de la dé-traditionnalisation, la plupart des actions et des relations humaines, comme le mariage, le rapport entre les sexes et le choix de carrière, sont davantage laissées aux choix des agents et ne découlent plus de la division de travail liées à l’appartenance de sexe ou de classe). Si sa réflexion sociologique est sujette à débat, sa conception de la mondialisation est très contestable. Elle est analysée comme construisant une nouvelle notion de l’espace et du temps. Elle est aussi présentée comme une fatalité. Cette approche acritique passe complètement sous silence la nature de classe de la mondialisation, les stratégies d’acteurs comme les multinationales, la Banque Mondiale, le FMI, les élites étatiques, les lieux de rencontre des élites (Bilderberg, Trilatérale). Cette approche, à l’opposé de celle du duo James Petras-Henry Veltmeyer dans « La Face cachée de la Mondialisation », évacue commodément des notions comme l’impérialisme et les conflits de classe et favorise l’image que Giddens se fait de la société : celle d’un espace consensuel. En outre, comme le souligne P. Marlière, cette conception « reprend, comme lois établies, les présupposés majeurs des idéologues de la dérégulation économique ».L’auteur ajoute que « dans son analyse, aucune solution de rechange n’est envisagée. Aucune discussion sur le coût humain ou social d’une telle tendance n’est ébauchée. S’il observe que la ‘grande volatilité’ des marchés financiers a été favorisée, dans une large mesure, par les gouvernements occidentaux (…), ce fait est relevé en passant, sans que cela n’appelle de commentaires particuliers de sa part ».
Ces trois tendances – mondialisation, dé-traditionnalisation et réflexivité sociale accrue - rendraient l’idéal socialiste moins pertinent. Dans « The Third Way », ouvrage placé sous le haut patronage de Blair, il affirme que le socialisme et la « vieille » social-démocratie ont vécu. Il se fait le défenseur d’une « troisième voie » entre le néolibéralisme thatchérien et cette social-démocratie : l’Etat, chargé de la formation des individus, ne doit pas intervenir dans l’économie. Il doit par contre s’atteler à mettre en place cette société consensuelle que l’ex-directeur de la London School of Economics appelle de ses vœux.
La voie blairiste en action
Durant la campagne électorale de 1997, Blair a martelé : « Nous serons élus comme New Labour. Nous gouvernerons comme New Labour ». L’action gouvernementale de celui-ci est analysée en long et en large par l’auteur. Elle n’implique aucune remise en cause des paradigmes et des acquis du thatchérisme dans le domaine de la politique socio-économique. Quant à la politique étrangère, si Blair a en un premier temps nourri l’espoir d’être plus pro-européen que ces prédécesseurs, il s’est affirmé, plus rapidement qu’on ne le croit, comme un ultra-atlantiste. Il a engagé la Grande-Bretagne dans la guerre d’agression contre l’Irak. Il s’est opposé à toute vision multipolaire des relations internationales. En outre, il a milité pour l’intégration des pays de l’Est dans l’Union Européenne, pays souvent très atlantistes, ce qui a ruiné l’idée d’une Europe unie au plan politique et autonome par rapport à Washington. Enfin, il s’est opposé virulemment à tout ce qui serait de nature à favoriser l’Europe sociale.
Dans le domaine des services publics, le gouvernement Blair a poursuivi la politique de privatisation initiée sous Thatcher et Major. Il l’a fait en recourant à une formule imaginée par les Tories dans les années 90 : la PFI (Private Finance Initiative). P. Marlière décrit son fonctionnement de la manière suivante : « l’Etat contracte l’achat de services de longue durée auprès du secteur privé. Ce dernier fournit le financement nécessaire et accepte, en théorie, de couvrir les risques inhérents au développement du projet. En retour, il reçoit le droit d’exploiter le service. L’entreprise privée a la responsabilité de construire et de maintenir en l’état l’infrastructure, et fait supporter à l’Etat le coût des services pendant une période comprise entre 20 et 30 ans ». L’engagement du privé à couvrir les risques est tout théorique. « Dans de nombreux cas, l’Etat a consenti à financer en partie le projet. Il a fait don d’une somme d’argent public à une entreprise privée pourtant censée supporter l’intégralité des risques liés à l’exploitation du service ». Dans le domaine de la santé, on a constaté des dysfonctionnements divers et graves depuis le recours aux PFI. Dans le cas d’une infirmerie à Carlisle (Nord de l’Angleterre), construite dans le cadre d’un PFI, les infrastructures sont de faible qualité, les conditions de sécurité sont inadéquates et insuffisantes, le nombre de lits est en dessous de ce qui est nécessaire pour couvrir la demande. De façon générale, depuis l’institution des PFI, le nombre de lits dans les hôpitaux a baissé, tout comme le volume de soin et de personnel médical. Malgré ces résultats peu probants, la formule fut aussi appliquée à d’autres domaines, comme les transports (le métro de Londres par exemple, malgré une forte opposition).
P. Marlière souligne aussi que les PFI s’inscrivent dans une stratégie globale de privatisation par laquelle les multinationales veulent s’emparer des services et entreprises publics et de la part qu’ils représentent dans le PIB des pays. « Les Etats-Unis et l'Union européenne, écrit -il, soutiennent une telle démarche. Ils estiment qu'il est de leur intérêt de permettre à leurs multinationales d'accroître leurs parts de marché, car ils y voient une source de prospérité économique pour leur économie nationale ». A ce titre, cette formule pourrait bien faire de la Grande-Bretagne le laboratoire européen de la privatisation des services publics. Laquelle peut être replacée dans le cadre de la stratégie globale de mondialisation, qui, comme le soulignent Petras et Veltmeyer, vise à éliminer les alternatives politico-économiques au néolibéralisme et à empêcher toute politique de redistribution. Qu’un gouvernement censé défendre les intérêts du salariat participe avec autant d’enthousiasme à pareille stratégie est consternant. On aurait en effet tort de ne voir dans le blairisme qu’un pragmatisme, alors qu’il implique une profession de foi dans la libre entreprise et le libre échange. Blair a soutenu inconditionnellement l’AMI et n’a pas hésité à stigmatiser les mouvements altermondialistes, qualifiés dans le cas de Göteborg de « cirque itinérant d’anarchistes ». Il a d’ailleurs salué publiquement le « travail » de la police italienne à Gênes en juillet 2001 (« Seul monsieur Bush a osé lui emboîter le pas … », écrit P.Marlière). Il s’est ensuite envolé pour l’Amérique latine où il a incité ses hôtes mexicain, brésilien et argentin à hausser le rythme en matière de privatisation et de libre-échange. Il a réitéré sa stigmatisation des altermondialistes aux journalistes qui l’accompagnaient, allant jusqu’à dire que leur « message simpliste » lui rappelle, comme par hasard, celui de l’Old Labour. Il est vrai qu’il n’est guère en odeur de sainteté auprès des leaders travaillistes historiques. Le Labour penche actuellement à ce point à droite que même un Roy Hattersley, qui, selon les critères des années 70, représentait l’aile droite du parti, est un des critiques les plus virulents de la voie blairiste.
Cette voie se heurte cependant à des résistances, en particulier de la part des syndicats. L’auteur constate l’arrivée d’une nouvelle génération de syndicalistes, âgés de 40-50 ans et opposés au blairisme. Les dirigeants inféodés au New Labour ont été durement sanctionnés par la base. Ces nouveaux syndicalistes axent leur approche sur la défense des services publics, la lutte contre les discriminations racistes et sexistes sur le lieu de travail et la formation professionnelle continue des travailleurs. Il reste à savoir si ces transformations du syndicalisme britannique seront durables.
Les autres partis sociaux-démocrates sur la voie blairiste
P. Marlière analyse aussi dans l’épilogue de son ouvrage la blairisation du PS français. En théorie, celui-ci a cherché à se démarquer de la Troisième Voie. Les tentatives de distinction doctrinale, que ce soit celle de Lionel Jospin et celle de François Hollande sont pourtant restées « vagues » et n’ont pas été approfondies et enrichies. Quant à la pratique gouvernementale, elle ne diffère pas radicalement de celle du New Labour : « le même respect des ‘équilibres budgétaires’, le même refus des hausses d’impôt pour les plus riches, les mêmes privatisations et le même fatalisme vis-à-vis de la mondialisation néolibérale ». Cette blairisation s’est poursuivie lors de la campagne de Ségolène Royal, qui fut une campagne droitière axée sur la sécurité et les mœurs. Mais face à la démagogie décomplexée des partisans de Sarkozy, le PS ne pouvait être que perdant : « La droite a gagné triomphalement en étant de droite. Un PS ‘blairisant’ a perdu spectaculairement en n’étant pas clairement de gauche ».
Mais cette Troisième Voie participe, dans sa forme la plus droitière, d’un mouvement de convergence en Europe. « Tony Blair, puis Gordon Brown n’ont fait en réalité que parachever un cycle révisionniste inauguré en catimini dans les années 1980 par François Mitterrand, Michel Rocard, Felipe Gonzales, Bettino Craxi, Andrea Papandreou, Wim Kok ou Neil Kinnock », écrit P. Marlière. Alors que la précarité et la pauvreté augmentent, que les inégalités se creusent et que le capitalisme financier montre sa furie autodestructrice, la social-démocratie européenne, belge y compris, s’est engagée dans une impasse. Il est urgent de redéfinir un projet socialiste fondé sur un contrôle collectif de l’économie, une redistribution de la richesse et la défense des services publics et des acquis sociaux. La gauche doit redevenir, pour reprendre P. Marlière, une force « de réformes radicales dans la quasi-totalité des pays en Europe ». Reste à savoir comment. Le débat est ouvert.
- P. MARLIERE, La social-démocratie domestiquée. La voie blairiste, collection Fil Rouge, éditions Aden, 2008.
Nieuwslijnmeer

- Indymedia.be is niet meer
- Foto Actie holebi's - Mechelen, 27 februari
- Lawaaidemo aan De Refuge te Brugge
- Recht op Gezondheid voor Mensen in Armoede
- Carrefour: ‘Vechten voor onze job en geen dop!’
- Afscheid van Indymedia.be in de Vooruit in Gent en lancering nieuw medium: het wordt.. DeWereldMorgen.be
- Reeks kraakpanden in Ledeberg met groot machtsvertoon ontruimd
- Forum 2020 en de mobiliteitsknoop
- Vlaamse regering kan niet om voorstel Forum 2020 heen (fietsen)
- Fotoreportage Ster - Studenten tegen racisme

















